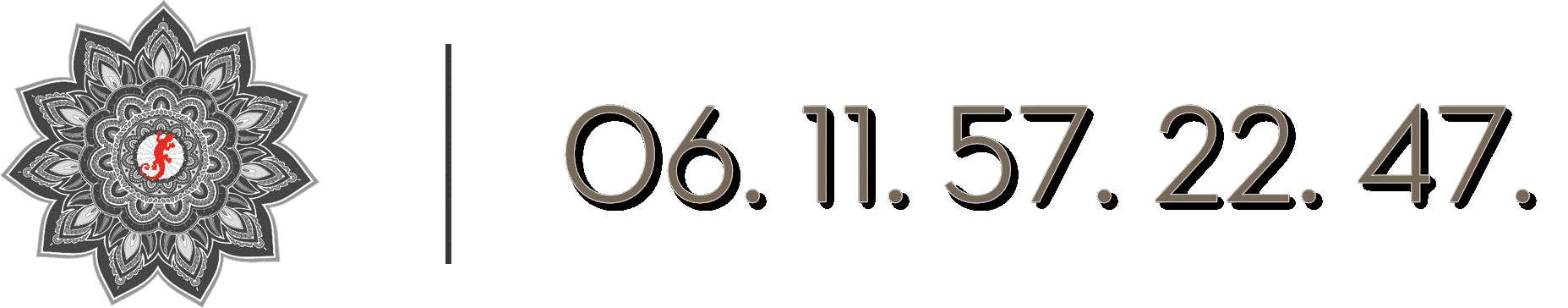Est-ce que les animaux ont un égo comme nous ?

Lors d’une présentation de la communication intuitive animale, une personne m’a posé cette question. Est-ce que les animaux ont un égo (selon moi) ? Ayant trouvé cette question très intéressante, je la réaborde ici.
Par simplification, je parlerai ici des mammifères et principalement de ceux que l’on rencontre au quotidien. Les espèces avec lesquels je fais le plus de séances de communication animale. C’est-à-dire chats, chiens, chevaux. Des animaux supérieurs comme on dit, car je ne peux pas aborder toute la complexité et diversité des formes de vie psychobiologiques.
Il s’agit également de garder à l’esprit que nous comparons la vie psychique d’un animal et son intelligence par rapport à la nôtre. Ce qui implique un point de vue orienté, normatif par rapport à elle. Et non pas pour celles qu’elles sont dans l’absolu.
J’utilise par simplification, dans ce texte, les mots animaux ou animal, cheval, chien, chat comme des synonymes. Ils sont au pluriel ou au singulier uniquement en fonction de la rédaction et non dans un but restrictif ou généralisant.
1/ Qu’est-ce que l’égo ?
En Premier lieu, pour se mettre d’accord sur ce dont on parle, qu’est-ce que l’égo ?
La définition traditionnellement donnée de l’égo (des Hommes) est la suivante :
Représentation et conscience que l’on a de soi-même.
L’égo est une partie de notre mental qui synthétise l’image de nous-même. En positif mais aussi en négatif. Et qui croit avoir une identité propre. Au point de chercher à mener/diriger nos actions et pensées. On peut repérer notre égo en action quand on se compare/confronte aux autres, c’est à dire à l’extérieur. En réalité, selon Jung, l’égo dépend du Soi, mais ça, il ne le ressent pas.
L’égo comprend notre esprit, nos pensées, notre conscience.
C’est donc la conscience de qui on est. Et le fait de chercher à garder le contrôle de ce qu’on croit être.
2/ Les animaux ont-ils un égo ?
Maintenant que la définition est faite, revenons à la question initiale. Un animal a-t-il un égo ?
Avant de vous donner mon avis en tant que praticienne en communication animale, voyons ce qu’il en est au niveau psychologique. Car il s’agit de nuancer et de vouloir comprendre la vie psychique animale.
Les animaux peuvent-ils avoir un égo ?
Pour avoir un égo, un animal doit avoir un esprit, des pensées et une conscience. Car ce sont les éléments nécessaires à la construction de l’égo.
Un animal a-t-il un esprit ?

C’est-à-dire des activités mentales conscientes et inconscientes. La réponse est oui. Un chat a conscience de son corps, mais aussi de ce qu’il veut ou préfère faire. Manger, jouer, chasser, interagir ou rester seul un petit moment. Et a contrario, il n’a pas forcément conscience des causes de son anxiété. Selon le type
Un podcast sur France Inter avec Florence Burgat parle de l’inconscient des Animaux.
De plus, il ne fait plus aucun doute aujourd’hui que les animaux aient des émotions. Et c’est par les émotions qu’on intègre des apprentissages ou non.
Un animal a-t-il des pensées ?
Sujet à débat depuis longtemps. Anciennement on répondait par la négative. En lui prêtant uniquement la capacité à réagir à son environnement, à répondre aux besoins fonctionnalistes. Ou encore à hériter des instincts de son espèce (ce que nomme Freud comme l’héritage archaïque). Mais ne disait-on pas, plus ou moins, la même chose des enfants ou des femmes aux siècles derniers ?!
Et ce n’est pas parce qu’on n’a pas accès à la vie intérieure animale qu’elle n’existe pas. C’est d’ailleurs ce que permet de la communication animale. Accéder à plus de profondeur dans ce qui est transporté par un animal. Et ne pas se limiter à ce qui est observable, à leurs comportements. Comportement qui peut poser un problème et être mal compris. En raison d’un code ou d’un langage mal interprété.
Aujourd’hui, les recherches tendent à montrer que la pensée animale est capable de raisonnement, d’abstraction et de représentation. Un cheval qui préfère partir plus loin dans le pré plutôt que d’obéir à une personne, ne le fait pas par instinct ou réaction. Ce cheval fait un choix et met en oeuvre un comportement adapté à ce choix. Il ne la bouscule pas, il part simplement au lieu de rester. Il pense et réfléchit selon et grâce aux expériences accumulées depuis sa naissance.
Les chevaux sont même capables de reconnaître les émotions des personnes sur photo !!
On sait également que l’apprentissage pour un animal va plus vite et va mieux l’intégrer si on récompense ses bonnes actions plutôt que de punir ses erreurs. C’est également la preuve de leur capacité à construire des schémas et des modèles.
Un animal a-t-il une conscience ?

Un animal a conscience du monde extérieur, c’est-à-dire de son environnement, de la réalité. Et sans doute encore plus que les humains.
Il a également conscience de lui (mais différemment d’un humain). Un chien sait qu’il ressent et reconnaît ses états intérieurs (agréables ou non). Il a conscience de ce qu’il fait (selon ses propres références). Il a également conscience que c’est lui qui vit les choses. Qu’il est un être, et qu’il est distinct des autres au sein de son espèce ou des autres espèces. Il a conscience de vivre et que les autres peuvent s’adresser à lui. Et qu’il interagit par le biais de ce qui le caractérise de son tempérament, de son caractère, de sa mémoire, de son histoire… Tout ce qui fait qu’il est lui-même.
Mais un animal n’a pas de conscience réflexive, ce qui est du domaine du retour sur soi. Il est mû par des envies, des attentes, des motivations… C’est par le feed-back expérimental qu’il évoluera et deviendra progressivement celui qu’il apprend à être. Ce n’est donc pas en réfléchissant sur lui-même et en se remettant en question (comme un travail sur soi ou en développement personnel pour donner un exemple que l’on connaît bien). Je pense, humblement, que c’est un des éléments qui fait qu’ils n’ont pas d’égo.
L’animal se vit directement, tel qu’il se sent. C’est-à-dire qu’il n’a pas de méta-position (méta = témoin). Il a une conscience objective. Mais sa conscience subjective est sans doute différente et avec moins de mentalisation que celle d’une personne. Car elle est en lien avec le phénomène de la pensée.
Et enfin, pour ce qui est la conscience morale, je crois que c’est une autre des différences (en plus des capacités cognitives) qui fait que l’égo n’existe pas chez l’animal. Le bien ou le mal n’est pas représenté ni vécu de la même manière. Il doit apprendre les codes ou signaux sociaux par le biais d’un congénère ou de son groupe. Mais je ne pense pas que les animaux aient la notion de bien et de mal ou de juste et injuste. Pour eux, il y aura des comportements corrects ou incorrects envers un congénère ou nous. Je parlerais plutôt d’une conscience sociale.
De plus, l’animal, contrairement à nous, ne cherche pas à se sentir le plus important vis-à-vis des autres. En cela également, ils différent de nous, très positivement. Ils évitent l’écueil d’agir par ce besoin de se sentir important. Même si, paradoxalement, eux nous font sentir importants à leurs yeux.
Je prends contact pour mon Animal
3/ Les animaux ont-ils une identité ?
Nous avons vu qu’un animal avait globalement tout ce qu’il fallait pour construire un égo. Un esprit, des pensées, une conscience avec, cependant, des différences avec ceux de l’Homme. Sans pour autant en construire un. Alors peut-être les animaux ont-ils plutôt une identité ?
Pour avoir une identité au sens qu’on lui accorde pour un Homme, il faudrait que l’animal ait une identité externe (objective) et interne (subjective). De plus, pour avoir une identité, il est d’abord nécessaire d’avoir un égo. Ce qu’il n’a pas. Pour autant un animal a bien une identité, qu’il vit comme une place auprès de ses congénères.

Un animal perçoit ses états intérieurs et peut percevoir ceux de ses congénères et agir en fonction de ceux-ci. Il construit son identité à partir de ses réactions avec les autres de son groupe ou de son espèce qu’il rencontre et avec lesquels il interagit.
Je pense qu’un cheval a une identité extérieure. Une identité sociale devrais-je dire. Acquise par le biais de ses interactions et capacités physiques autant que mentales. Elle devient une identité intégrée avec la récurrence des comportements de ses congénères pour devenir un état, une conscience de soi, un statut et un rôle dans un groupe défini. On s’en rend compte quand on communique avec les chevaux.
Là, il est encore nécessaire de nuancer les choses. La conscience peut se découper en 3 sous-domaines.
Une identité sociale mais pas une identité idéalisée

Ils ne construisent pas une identité imaginée ou idéalisée plus confortable. Ça c’est le rôle de l’égo pour l’humain. Eux, ils acceptent qui ils sont dans la totalité de leur réalité. Et c’est leur point de départ à leur façon de se vivre. Ils n’occultent pas ce qui les dérange en se créant une identité vis-à-vis d’un idéal ou d’un souhait. Un cheval est un leader parce qu’il en a les capacités. Il est ce qu’il peut être selon ses capacités, son physique, son tempérament et selon la composition du reste du troupeau. Tous auront des ambitions ou des envies à partir de leur tempérament et caractère.
Cela implique que les animaux intègrent leurs forces ou leurs faiblesses à leur propre représentation. Ils savent qui ils sont. Et ils se vivent tels qu’ils sont. Ils ne cherchent pas à mener des actions dans le but de construire une image intériorisée confortable ni de préserver une image aux yeux des autres congénères. Ils sont bien plus directs et “entiers”.
Même quand ils aimeraient être plus forts ou plus autre chose, ils ne refusent pas le manque qui est en eux. Ils se connaissent tels qu’ils se vivent. Ils sont ce qu’ils font. Ce qu’ils vivent.
Notre identification à notre égo

Je pense que notre égo est une des façons que nous, Humains, avons de “nous penser”/ de nous représenter. Et que pour calmer ou apaiser un peu nos peurs et souffrances, notre mental créé ce “petit personnage” auquel on se raccroche. Une identité intériorisée et idéalisée. Ce dernier nous en fait voir de toutes les couleurs. Il aime nous faire souffrir puisque l’un de ses buts est de manifester son existence et de favoriser notre dépendance envers lui. Parfois en activant nos peurs, parfois en nous faisant croire en une identité réconfortante, toujours en nous comparant aux autres.
Résultat, nous sommes plus ou moins guidés (dans nos actions) par notre volonté de créer ou de maintenir notre image (celle que nous avons de nous-même mais aussi celle que les autres ont de nous). Peut-être est-ce le résultat de notre individualisation extrême en tant qu’humain ?! Ou est-ce un moyen de mettre à distance ce qui nous fait fortement souffrir ? Au point de ne plus connaître l’origine d’un problème dans nos vies. Toujours est-il que nous avons sincèrement et profondément l’impression d’être celui ou celle que nous croyons être.
4/ Une identité propre qui peut être inhibée
Lors des communications animales, je vois bien qu’ils ne cachent rien. Ils ne limitent pas le “contenu” auquel ils donnent accès. Au contraire, ils se livrent totalement. Cependant, la manière dont ils se livrent dépend de leur caractère ou de leurs difficultés à explorer ce qui les fait souffrir. Mais ils ne se leurrent pas eux-mêmes. Et encore moins nous. Ils ne mettent pas en oeuvre en protection une image individuelle souhaitée qui serait différente de la réalité.
En revanche, ce dont je me rends également compte, c’est que parfois, ils se sentent d’une façon qui n’est pas tout à fait leur vraie nature (innée). C’est souvent le résultat de leurs expériences et/ou de nos agissements sur eux. La communication animale permet d’y voir plus clair dans leurs expériences, leurs émotions ou leurs mémoires émotionnelles traumatisantes. De retrouver leur équilibre intérieur et leur véritable identité. Celle qui est innée, leur tempérament. Et de la renforcer par les expériences positives de la vie. Et ainsi être eux-mêmes, le Soi au sens psychologique du terme.
5/ Quête de réalisation chez les animaux
Mais ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas d’égo qu’ils n’ont pas de désirs quant à leur rôle ou leur positionnement dans leur vie. Ou qu’ils n’ont pas la volonté d’atteindre un but (pour eux ou auprès de nous). Quand notre relation est favorable, on se rend compte qu’ils peuvent développer des aptitudes et des capacités spécifiques. Dont certains sont vraiment friands. Leur intelligence se développe par l’enrichissement de leur quotidien et de leurs activités. Des développements qu’ils ne pourraient pas faire dans la nature car ils sont focalisés à répondre à leurs besoins naturels et leur de sécurité.
Je parlerai alors plus de réalisation. Au sens, réalisation de Soi. Ils cherchent à vivre une expérience qui leur permette d’exprimer leur nature mais aussi d’atteindre le but individuel car c’est vécu positivement. C’est un des objectifs des communications animales, les aider à atteindre cette réalisation grâce à vous.
Tous ces éléments sont intéressants à connaître, quand on veut adopter un chien par exemple.
Je veux une séance pour mon Cheval
En conclusion

Les informations de cet article comprennent des données de domaines différents : éthologie, psychologie animale, phénoménologie, comportementalisme, philosophie. Les études et connaissances actuelles montrent sans conteste que la vie psychique des animaux est bien plus grande que celle qu’on croyait, sans pour autant avoir les mêmes caractéristiques que les nôtres. Ce qui ne la situe pas pour autant plus basse ou ayant moins de valeur. Au contraire, apprendre la signification d’un comportement spécifique est à la fois magnifiquement intéressant et utile pour la relation ou le travail commun.
Je vous ai exposé ces informations à la fois parce que je pense que cela est important pour savoir de quoi on parle, et à la fois par ce que c’est intéressant. Egalement car cela évite de tomber dans des représentations erronées de la connexion animale.
Les animaux ont une vie psychique intense et sans être exactement comme celle de l’Homme, elle est à prendre en compte et à mieux évaluer. Quant à leur intelligence, elle existe, sans conteste. Elle est, simplement, différente et plurielle.
Je ne pense donc pas que les animaux supérieurs aient un égo, ou une identité subjective, selon mes informations et expériences professionnelles. Mais chat, chien, cheval forment, à n’en pas douter, une immense palette de personnalités individuelles que nous avons la chance de pouvoir côtoyer. Et la chance de pouvoir explorer par la communication animale.
Article du 17 février 2020
Envie de lire un article sur le bien-être animal et la communication animale ?